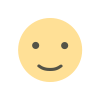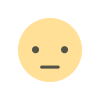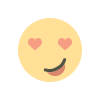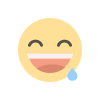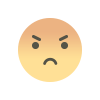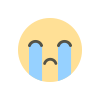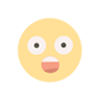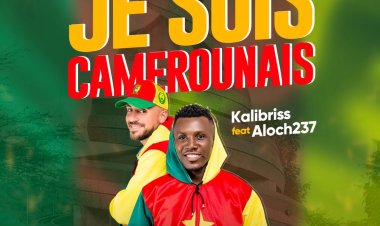L’IA au bureau ou le pire stagiaire
Chaque mois, Laure Coromines décrypte les tendances numériques. Le recours intempestif aux intelligences artificielles, encouragé par les entreprises, serait contre-productif, selon de nombreuses études .

Créatures grotesques, comptines pour enfants entêtantes ou vidéos historiques truffées d’erreurs… Le slop (« soupe » en français), ce contenu bas de gamme généré par ChatGPT et compagnie, infiltre aussi le lieu de travail : des textes uniformisés, pondus à la hâte et de piètre qualité. Envahissant boîtes e-mail et Google Drive, ils prennent la forme de messages obscurs, de rapports creux ou de présentations PowerPoint superfétatoires.
« Mon supérieur utilise l’IA [intelligence artificielle] à toutes les sauces, pour un résultat souvent médiocre. Au lieu de le recadrer, son propre chef attend qu’il ne soit pas là pour demander à mon équipe de tout reformuler dans son dos. Cela n’a pas de sens : on jette beaucoup de choses à la poubelle, puis on doit refaire nos présentations et notes stratégiques… Avec nos clients, il m’arrive de me retrouver très gêné lorsqu’on présente certains travaux », rapporte Maxime (tous les prénoms cités ont été modifiés), 30 ans, consultant à Paris dans l’une des entreprises de conseil IT (en technologie de l’information) les plus importantes du monde.
De l’autre côté de l’Atlantique, plusieurs études avancent que l’usage des IA génératives en entreprise s’avère souvent contre-productif. En septembre, un sondage de l’université Stanford a montré que 40 % des travailleurs américains avaient déjà reçu du contenu généré par l’IA de la part d’un collègue ou d’un manageur, et ce de toutes industries confondues. Une pratique qui provoquerait une perte de temps évaluée par tâche en moyenne à une heure cinquante-six minutes. Le temps qu’il faudrait pour déchiffrer et corriger ce travail bâclé.
Lus en diagonale, ces contenus arborent le verni du travail bien fait. Examinés de près, ils n’auraient, selon le sondage, « pas la substance nécessaire pour faire avancer de manière significative une tâche donnée ». Un bilan peu glorieux, qui est corroboré par d’autres études menées outre-Atlantique. Le Financial Times a épluché des centaines de documents (comptes rendus de réunions, transcriptions d’assemblées générales, rapports de résultats…) produits par les 500 plus importantes entreprises américaines. D’après le média, les entreprises parlent d’IA en permanence sans toutefois pouvoir expliquer en quoi la technologie les aide.
Ces études ne suffisent pas à brider l’enthousiasme des collègues de Maxime, nombreux à trouver désirable et valorisant d’être « AI-assisted » (« assisté d’une IA »). « Cela fait rêver ceux en recherche de gains de productivité magiques. Il faut dire qu’on baigne dans une culture empreinte de positivité et d’apathie, qui nous pousse à accepter le phénomène sans trop réfléchir. Remettre l’usage en question est inaudible », se désole Maxime. Et ce, même si, selon lui, les résultats ne sont pas probants. « On recycle de manière industrielle les choses déjà faites. On le faisait déjà avant, mais là, c’est une accélération du “tourner en rond”. »
Même sentiment d’exaspération pour Laurent, 39 ans, consultant dans le secteur de la banque à Paris. « Il y a toujours un collègue en réunion qui suggère de demander l’avis de ChatGPT. On reçoit ensuite par e-mail un résumé empli de banalité, sans aucune réelle analyse. Ces messages, c’est comme les pubs sur Internet, on essaie de les ignorer, mais c’est difficile. » Confiant, Laurent espère voir les choses s’améliorer. « Après la phase d’excitation, on entre dans le tunnel de la désillusion. Je pense que les usages vont se rationaliser. Peut-être qu’on arrivera à la conclusion que l’IA ne sert pas à grand-chose ? »
Comme Maxime et Laurent, Marie, trentenaire, rédactrice dans une agence de communication nantaise, est, malgré son scepticisme, fortement incitée à utiliser les IA. « Les gens surestiment le temps gagné. Dans la réalité, le gain sur nos missions est peut-être de 5 % si on ne veut pas rogner sur la qualité. L’IA s’apparente surtout à un stagiaire zélé à forte tendance mythomane. »
Ces dernières années, diverses sorties de route grand-guignolesques ont été mises au jour. En Australie, au début de l’année, le cabinet de conseil Deloitte a vendu au ministère de l’emploi un rapport de 237 pages (facturées 440 000 dollars australiens, environ 250 000 euros) bourrées d’erreurs produites par des intelligences artificielles. A New York, en 2023, un juge a mis à l’amende un avocat pour avoir produit devant la cour un mémoire juridique constitué uniquement d’affaires inventées par ChatGPT.
Malgré ces couacs, un mantra s’impose. Les IA ne sont que des outils qu’il suffirait d’apprendre à maîtriser, et dont il faudrait circonscrire les usages pour court-circuiter les dérapages. Pour la réflexion, les humains ; pour le reste, la machine.
Une position que ne partage pas entièrement Séverine Enjolras, sociologue du travail. « L’usage de l’IA est problématique à tous les niveaux : pour les exercices complexes, mais aussi pour ceux fastidieux et répétitifs. Même les tâches à peu de valeur ajoutée intellectuelle ont une vertu. Elles constituent une pause, une respiration, un repos cognitif. Le risque, c’est aussi de se voir submerger par les informations sans être capable de faire le tri et de conserver son esprit critique. »
En France, une étude de Bpifrance, parue en juin, montre que 43 % des dirigeants de PME-ETI auraient déjà adopté une stratégie IA. Les entreprises peinent pourtant à accompagner correctement leurs salariés, encouragés à utiliser une technologie présentée comme révolutionnaire. « Ce recours intempestif aux IA ne fait qu’aggraver le sentiment de perte de sens, notamment dans le tertiaire. Les fameux “bullshit jobs” décrits par l’anthropologue David Graeber deviennent encore plus “bullshit”. Alors forcément, on se désinvestit toujours plus de son travail », observe Séverine Enjolras.
Sur un forum Reddit, un internaute écrit dans une publication intitulée « Ras-le-bol de l’IA au boulot » : « J’ai dix ans d’expérience en science des données. Maintenant, je n’entends plus parler que de LLM [des modèles de langage entraînés sur de grandes quantités de données et capables de générer des textes] et d’IA agentique [un système d’IA capable d’atteindre un but précis avec peu de supervisions]. J’en ai assez de ces réunions. Je veux juste travailler, faire ce que je peux, la moitié de mon cerveau éteint, pendant encore dix ans et, avec un peu de chance, prendre ma retraite. »
En juillet, une étude du MIT révélait que 95 % des entreprises américaines n’ont aucun retour sur leurs investissements en IA. En attendant, personne ne rentre chez lui plus tôt grâce à Copilot ou Gemini




 Sandrine Mballa
Sandrine Mballa